Un salarié peut travailler plus de 6 jours consécutifs !
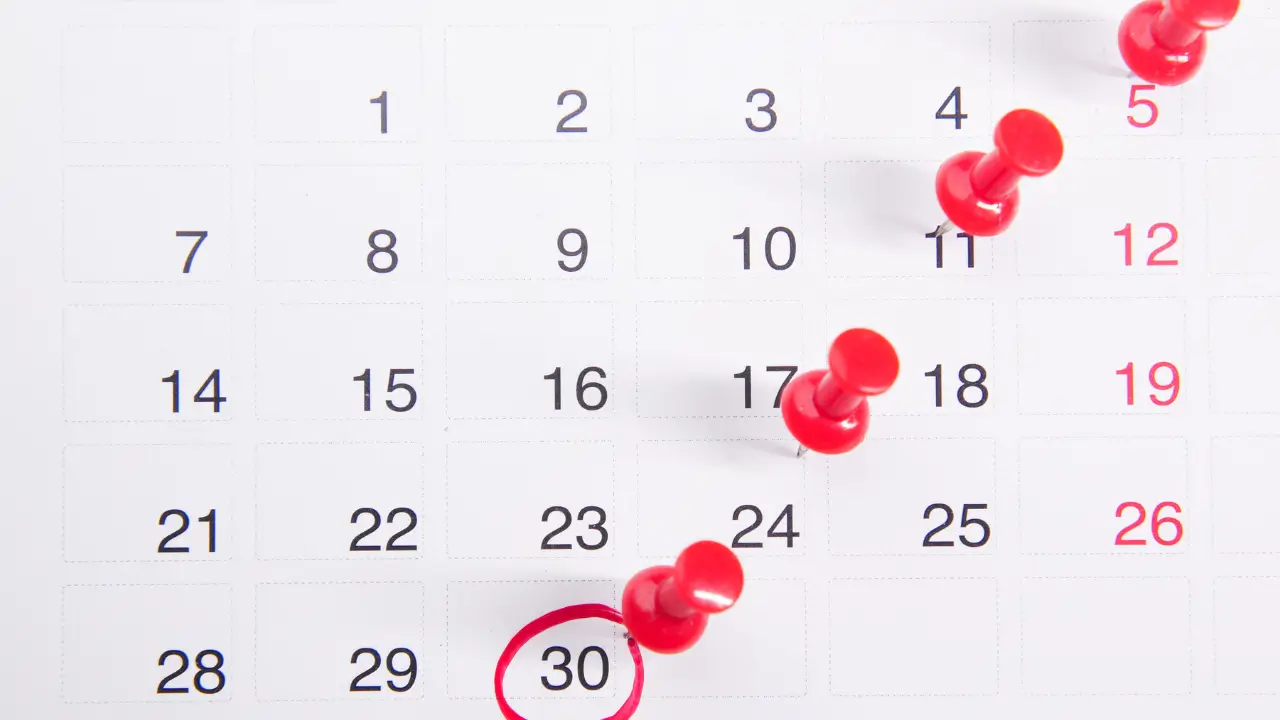
Par un arrêt majeur rendu le 13 novembre 2025, la Cour de cassation met fin à une incertitude juridique vieille de plusieurs décennies : un employeur n’est pas tenu d’accorder le repos hebdomadaire immédiatement après six jours de travail consécutifs, dès lors que ce repos est bien octroyé à l’intérieur de chaque semaine civile.
Ce faisant, la Haute juridiction consacre officiellement la possibilité, dans certaines organisations du travail, de faire travailler un salarié plus de six jours de suite, voire jusqu’à douze jours consécutifs, sans méconnaître le droit au repos hebdomadaire.
Cette décision, qui confirme la lecture administrative traditionnelle du Code du travail, apporte une clarification essentielle pour les employeurs comme pour les salariés, notamment dans les secteurs fonctionnant par roulement ou soumis à des contraintes événementielles.
Le cadre légal : interdiction de faire travailler plus de six jours par semaine
Le principe posé par l’article L. 3132-1 du Code du travail est clair : il est interdit à un employeur de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. Ce principe se traduit par l’obligation d’accorder à chaque salarié un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (art. L. 3132-2).
En pratique, cela signifie qu’un salarié qui termine son travail le samedi à 19 h ne peut en principe reprendre avant le lundi à 6 h, en raison de l’addition du repos dominical (24 h) et du repos quotidien (11 h).
Mais une question centrale demeure : qu’entend-on exactement par “semaine” ? S’agit-il de :
- la semaine calendaire, où toute période glissante de sept jours doit comporter un repos ?
- ou la semaine civile, allant du lundi 0 h au dimanche 24 h ?
Selon l’approche retenue, la règle n’a pas les mêmes conséquences.
En semaine calendaire, il serait impossible de dépasser six jours consécutifs. En semaine civile, en revanche, certaines organisations du travail peuvent conduire à un enchaînement plus long sans repos hebdomadaire, tout en restant légal.
A noter que certaines organisations du temps de travail permettent de déroger à ce repos hebdomadaire. C’est le cas notamment des cadres dirigeants. Pour en savoir plus sur les durées de travail, vous pouvez consulter notre fiche pratique sur le sujet.
Un débat ancien : pouvoirs publics et circulaires favorables à la semaine civile
Bien que le texte du Code du travail ne tranche pas explicitement cette question, les pouvoirs publics se sont déjà prononcés par le passé.
Dans deux réponses ministérielles, en 1976 et 1981, le ministère du Travail avait indiqué que la règle s’apprécie sur la base de la semaine civile. Cette position a ensuite été formalisée dans une circulaire DRT du 7 octobre 1992, qui précise que la semaine visée par l’interdiction de travailler plus de six jours commence le lundi à 0 h et s’achève le dimanche à 24 h.
Pourtant, malgré ces prises de position, aucune décision de la Cour de cassation ne s’était encore prononcée sur ce point, laissant persister une incertitude juridique, notamment pour les entreprises appliquant des repos hebdomadaires par roulement.
La décision de la Cour de cassation : confirmation de la position de l'administration
L’affaire : un salarié travaillant jusqu’à 12 jours consécutifs
Le litige à l’origine de l’arrêt du 13 novembre 2025 concernait un directeur des ventes amené à participer à plusieurs salons professionnels. Il affirmait avoir travaillé :
- 11 jours consécutifs du 3 au 13 avril 2018,
- 12 jours consécutifs du 3 au 14 septembre 2018.
Estimant que son employeur avait violé le droit au repos hebdomadaire, il avait pris acte de la rupture de son contrat. La cour d’appel lui avait donné gain de cause, requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur, contestant ce raisonnement, s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation tranche : le repos se décompte sur la semaine civile
Dans son arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation adopte clairement la solution fondée sur la semaine civile. Elle fonde son analyse sur plusieurs éléments :
- La directive européenne 2003/88/CE sur le temps de travail, telle qu’interprétée par la CJUE en 2017, n’impose pas que le repos soit accordé immédiatement après six jours de travail.
- Le Code du travail exige seulement qu’un repos hebdomadaire existe dans chaque semaine civile, sans préciser qu’il doit intervenir après une période maximale de travail consécutif.
- Par conséquent, rien n’impose à l’employeur de placer le repos juste après le sixième jour travaillé.
Ainsi, dès lors qu’un salarié bénéficie d’un jour de repos dans chaque semaine civile, il est possible qu’il travaille au-delà de six jours consécutifs — notamment lorsqu’il bénéficie d’un repos un lundi puis du repos dominical la semaine suivante, créant un intervalle de 12 jours de travail.
Une clarification qui sécurise certaines organisations du travail
Cet arrêt marque une évolution majeure :
- Pour les employeurs, il offre une sécurité juridique pour les plannings atypiques, notamment en hôtellerie-restauration, commerce, événementiel ou industries en continu.
- Pour les salariés, il rappelle que, malgré ces possibilités d’enchaînement, le repos hebdomadaire reste obligatoire chaque semaine, et que tout dépassement injustifié peut être contesté.
L’arrêt ouvre néanmoins un débat sur la santé et la fatigue au travail, certains s’inquiétant des risques liés à des périodes prolongées sans repos hebdomadaire.
N’hésitez pas à demander un audit juridique pour sécuriser vos pratiques et votre organisation du temps de travail. Vous pouvez consulter notre site pour plus de détails.
Si vous souhaitez lire la décision de la Cour de cassation, vous pouvez la retrouver sur le site de la Cour de cassation.


.svg)
.svg)
.svg)





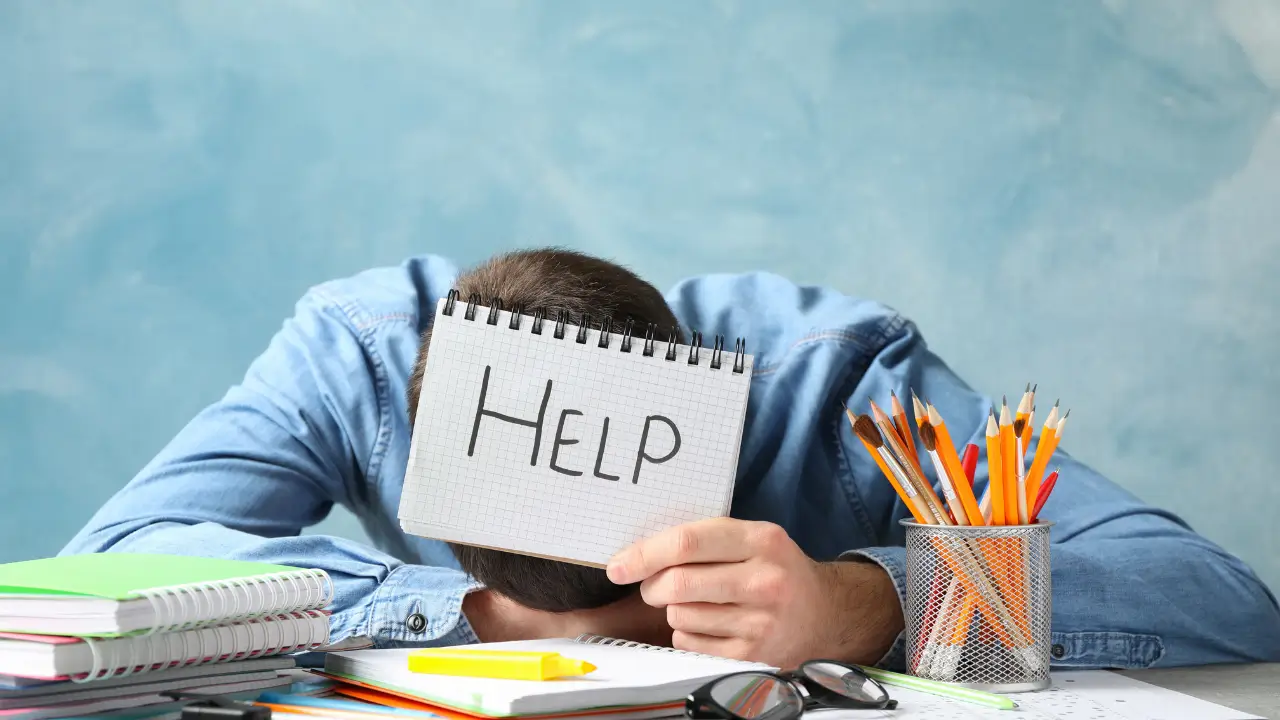




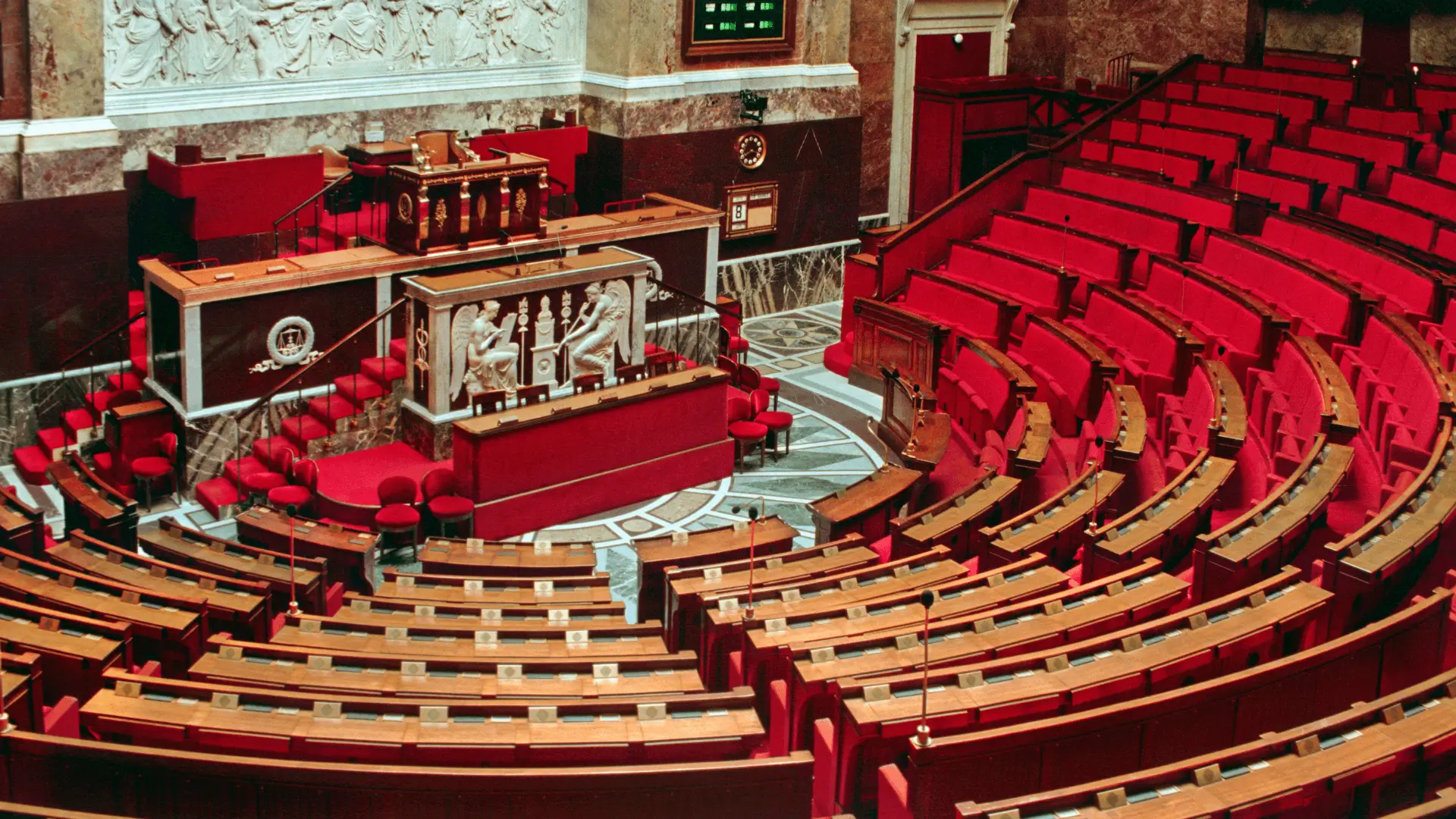




.svg)
.svg)







.svg)
