Prévenir le stress au travail : un impératif pour les employeurs
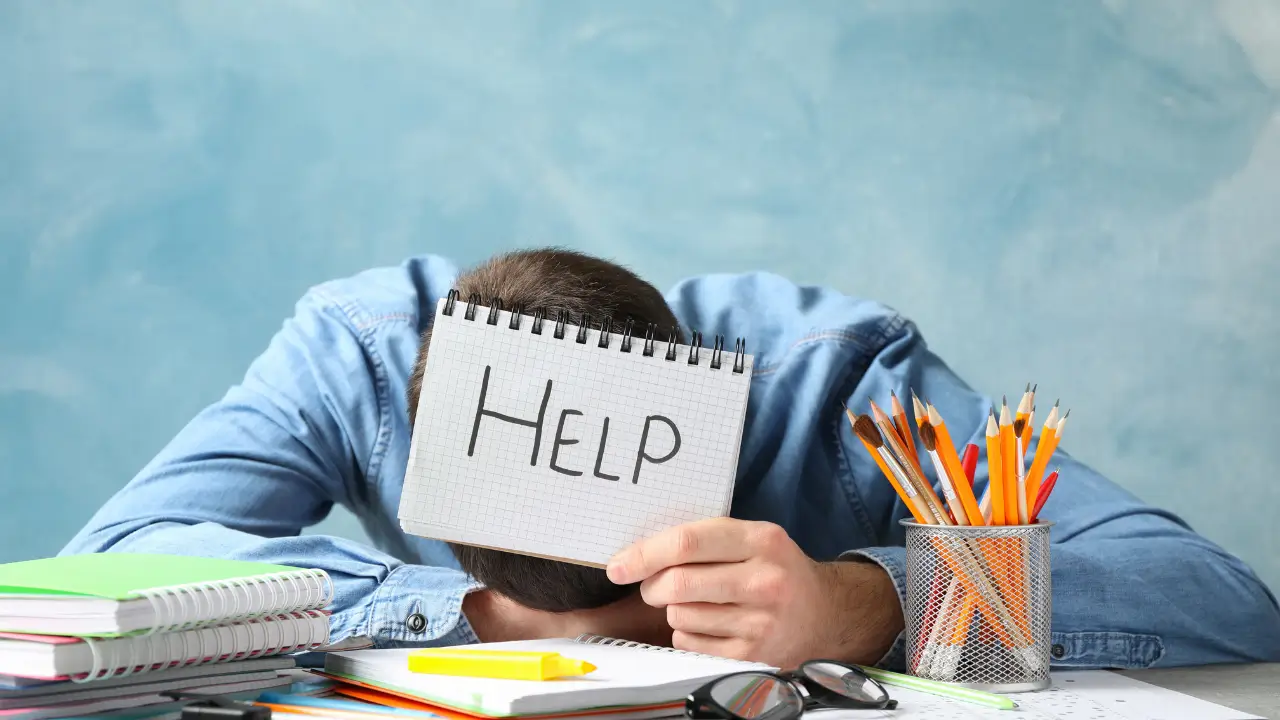
Le Ministère du travail a rédigé et mis en ligne le 25 septembre 2025 une fiche relative à la “prévention du stress au travail”.
Enjeu majeur de ces dernières années, la prévention des risques psycho-sociaux des travailleurs doit être un impératif pour les employeurs. Nous vous en disons plus !
Qu’est-ce que le stress professionnel ?
Le stress au travail se définit comme “un déséquilibre entre les contraintes imposées à un employé (objectifs, délais, pression, environnement, etc.) et sa perception de ses propres ressources pour y faire face.”
Selon l’Institut national de Recherche en Santé (INRS), physiologiquement le stress suit trois phases :
- Phase d’alarme : l’organisme se prépare à la réaction (combat/fuite).
- Phase de résistance : face à une situation stressante persistante, des efforts importants sont mobilisés.
- Phase d’épuisement : si la situation perdure ou s’intensifie, le salarié ne parvient plus à s’adapter, ce qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé physique et mentale.
Pourquoi le stress professionnel est-il un enjeu crucial pour l’entreprise ?
Le stress ne touche pas uniquement l’individu : il est souvent le symptôme de dysfonctionnements organisationnels (processus, management, communication, conditions matérielles).
Par ailleurs, les conséquences de ce stress professionnel peuvent être graves : troubles musculo-squelettiques (TMS), troubles anxieux ou dépressifs, burn-out, qui peuvent entraîner, parfois, la reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident du travail et à terme une possible inaptitude. Pour en savoir plus sur les répercussions financières de l'inaptitude, vous pouvez consulter notre fiche pratique sur le sujet.
Enfin, le stress professionnel peut avoir des impacts économiques et humains importants pour une entreprise : absentéisme, turnover, perte de motivation, productivité réduite, climat social détérioré…
Obligations légales de l’employeur
L’employeur est tenu, en vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés. Cela comprend ainsi la prévention des risques, l’information, la formation, l’adaptation des organisations selon l’évolution des risques.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) doit intégrer les risques psychosociaux (RPS), dont le stress.
Des accords nationaux (par exemple l’accord interprofessionnel relatif au stress de 2008) soulignent la nécessité d’une approche collective, d’anticiper, de diagnostiquer et de traiter le stress en entreprise.
Les facteurs de risques
La fiche du Ministère du travail identifie six grandes familles de facteurs qui favorisent stress et risques psychosociaux :
- Exigences du travail : surcharge ou sous-charge de travail, pression dans les délais demandés, objectifs flous ou irréalistes.
- Exigences émotionnelles : tâches impliquant de la charge émotionnelle, contact avec le public, gestion de la souffrance ou des émotions.
- Manque d’autonomie : absence de marge de manœuvre pour le salarié, contrôle excessif voire abusif.
- Rapports sociaux dégradés : isolement, rapports conflictuels, manque de soutien hiérarchique ou entre collègues.
- Conflits de valeurs : ce qui est demandé à faire à un salarié va à l’encontre des valeurs professionnelles de celui-ci.
- Insécurité socio-économique : instabilité de l’emploi, incertitudes sur l’avenir, manque de reconnaissance.
Ces facteurs peuvent s’exprimer à travers l’organisation du travail (horaires, charge, marge de manœuvre), les conditions de travail (environnement, ergonomie, nuisances), la communication (clarté des objectifs, des évolutions, des attentes) ainsi que les facteurs subjectifs (équilibre entre vie perso/pro, sentiment de ne pas être soutenu, reconnaissance, etc.).
Les leviers d’action pour l’employeur
Pour agir efficacement, le ministère identifie six axes principaux de prévention :
- Informer et former les travailleurs : sensibiliser aux signes de stress, aux outils de gestion, aux ressources internes ou externes.
- Réguler la charge de travail : éviter la surcharge, mieux gérer les délais et les objectifs, anticiper les pics d’activité.
- Garantir un soutien social solide : assurer un bon climat social, du soutien hiérarchique, des échanges entre collègues.
- Favoriser l’autonomie et la participation des salariés : permettre aux personnes concernées de contribuer aux décisions qui les affectent, donner du pouvoir d’action.
- Assurer une juste reconnaissance du travail : reconnaissance financière mais aussi symbolique, communication valorisante, retour d’information.
- Discuter des critères de qualité du travail : clarifier ce qu’est un travail bien fait, définir des critères clairs, cohérents, partagés.
Mise en œuvre pratique : démarche recommandée
- Cartographier / évaluer les risques
- Utiliser des questionnaires, audits ou entretiens pour identifier les points de tension dans l’entreprise, unité par unité.
- Intégrer les facteurs RPS dans le DUERP.
- Utiliser des questionnaires, audits ou entretiens pour identifier les points de tension dans l’entreprise, unité par unité.
Nous pouvons vous accompagner pour réaliser des audits organisationnels mais également vous aider dans la mise en place de la DUERP. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site.
- Mettre en place un plan d’action collectif
- Prioriser les actions selon l’urgence et l’impact, en concertation avec les représentants du personnel.
- Réguler les dysfonctionnements de façon collective (favoriser la cohésion d’équipe, recourir au dialogue social…)
Définir des objectifs clairs, mesurables (réduction de l’absentéisme, enquête de climat, etc.).
- Former et sensibiliser
- Sensibiliser managers et équipes aux risques, aux signes de stress.
- Former les managers à une gestion bienveillante, à la délégation, à la communication.
- Sensibiliser managers et équipes aux risques, aux signes de stress.
Notre académie prévoit des formations pour apprendre à communiquer. Nous vous invitons à découvrir notre catalogue sur le sujet.
- Modifier l’organisation du travail
- Ajuster les charges et les délais, clarifier les objectifs.
- Revoir les procédures, les outils, l’environnement, afin de limiter les nuisances.
- Ajuster les charges et les délais, clarifier les objectifs.
- Renforcer le soutien
- Encourager le dialogue, les retours d’expérience.
- Mettre à disposition des ressources : cellules d’écoute ou d’assistance psychologique, soutien du service de santé au travail.
- Encourager le dialogue, les retours d’expérience.
- Suivre, ajuster, pérenniser
- Mettre en place des indicateurs de suivi : satisfaction, taux d’absentéisme, turnover, indicateurs de stress.
- Suivre la charge de travail et le respect de certains droits assurant l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle comme le droit à la déconnexion
- Assurer que les mesures restent adaptées au fil du temps (changements organisationnels, effectif, contexte économique, etc.).
Nous vous invitons également à consulter la fiche du Ministère du travail sur le sujet.


.svg)
.svg)
.svg)


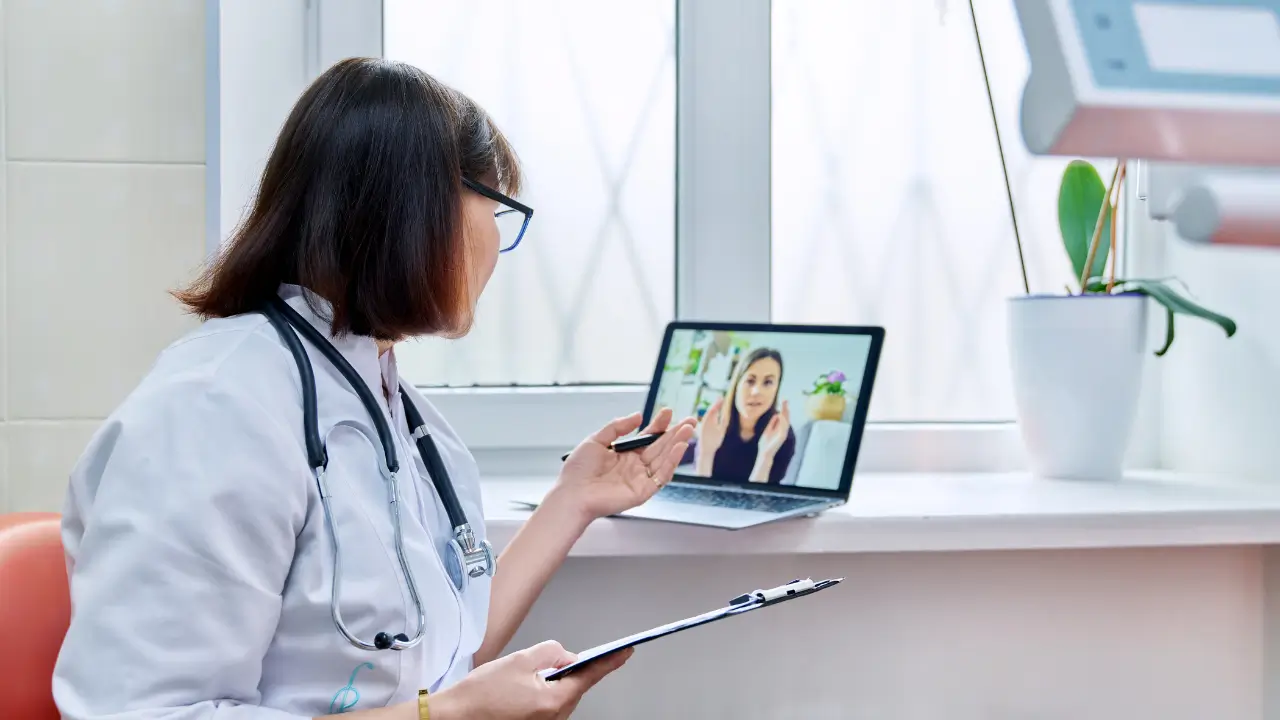

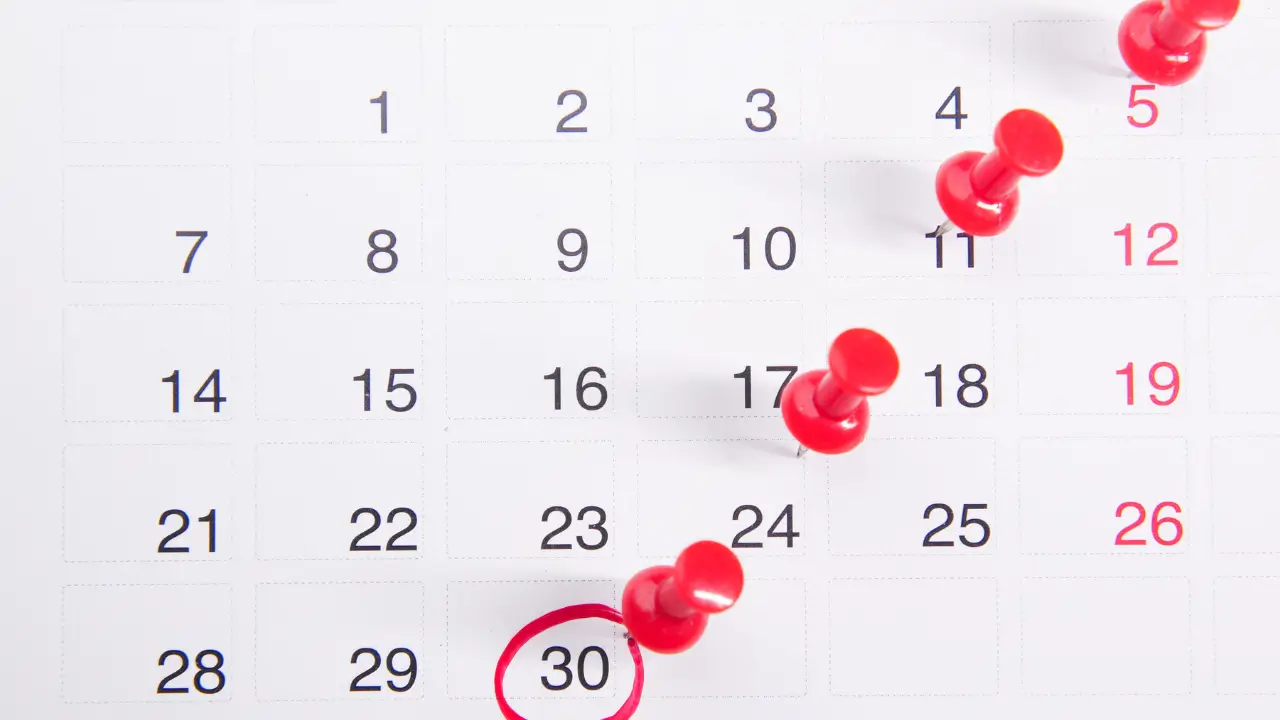




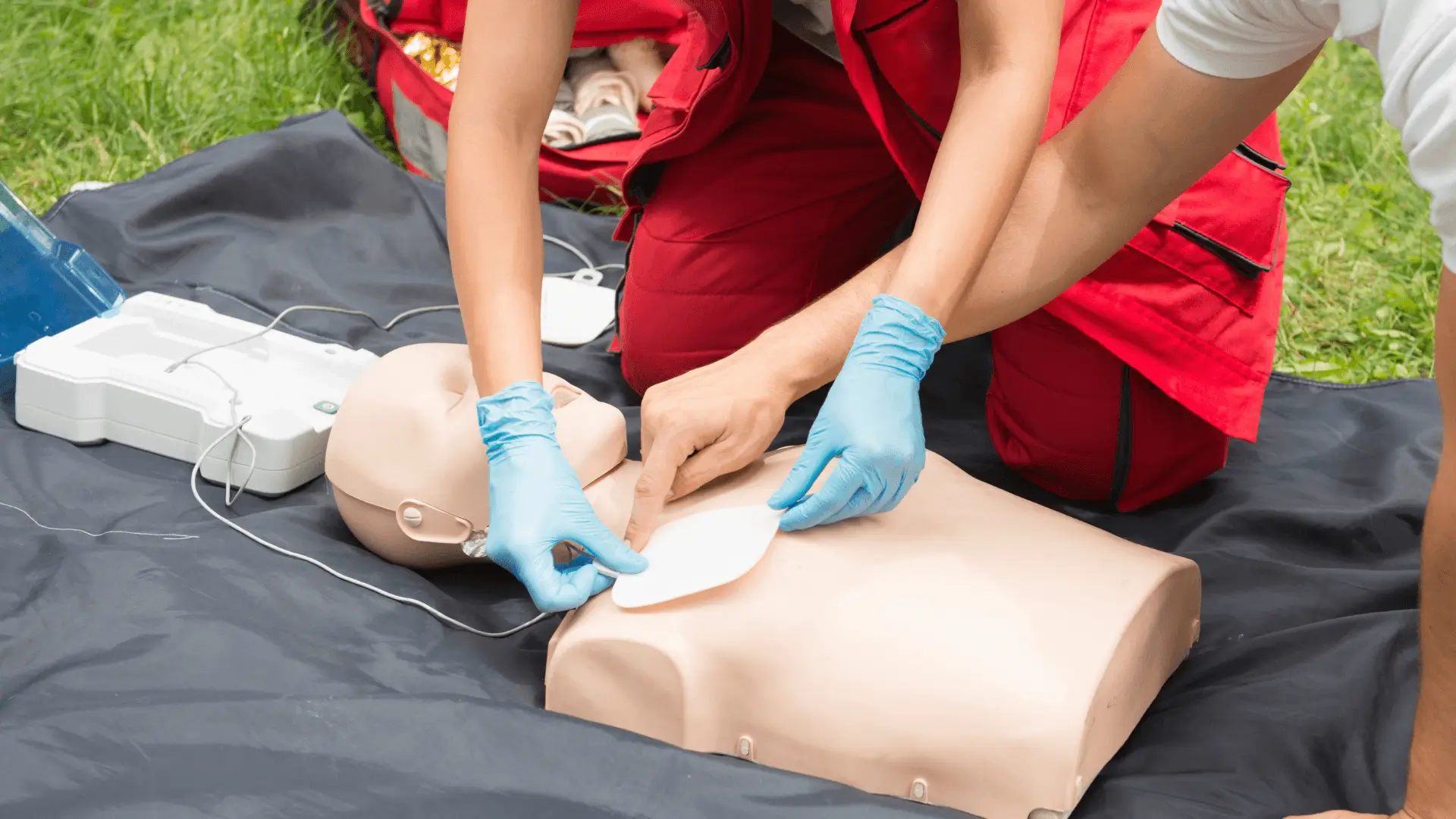

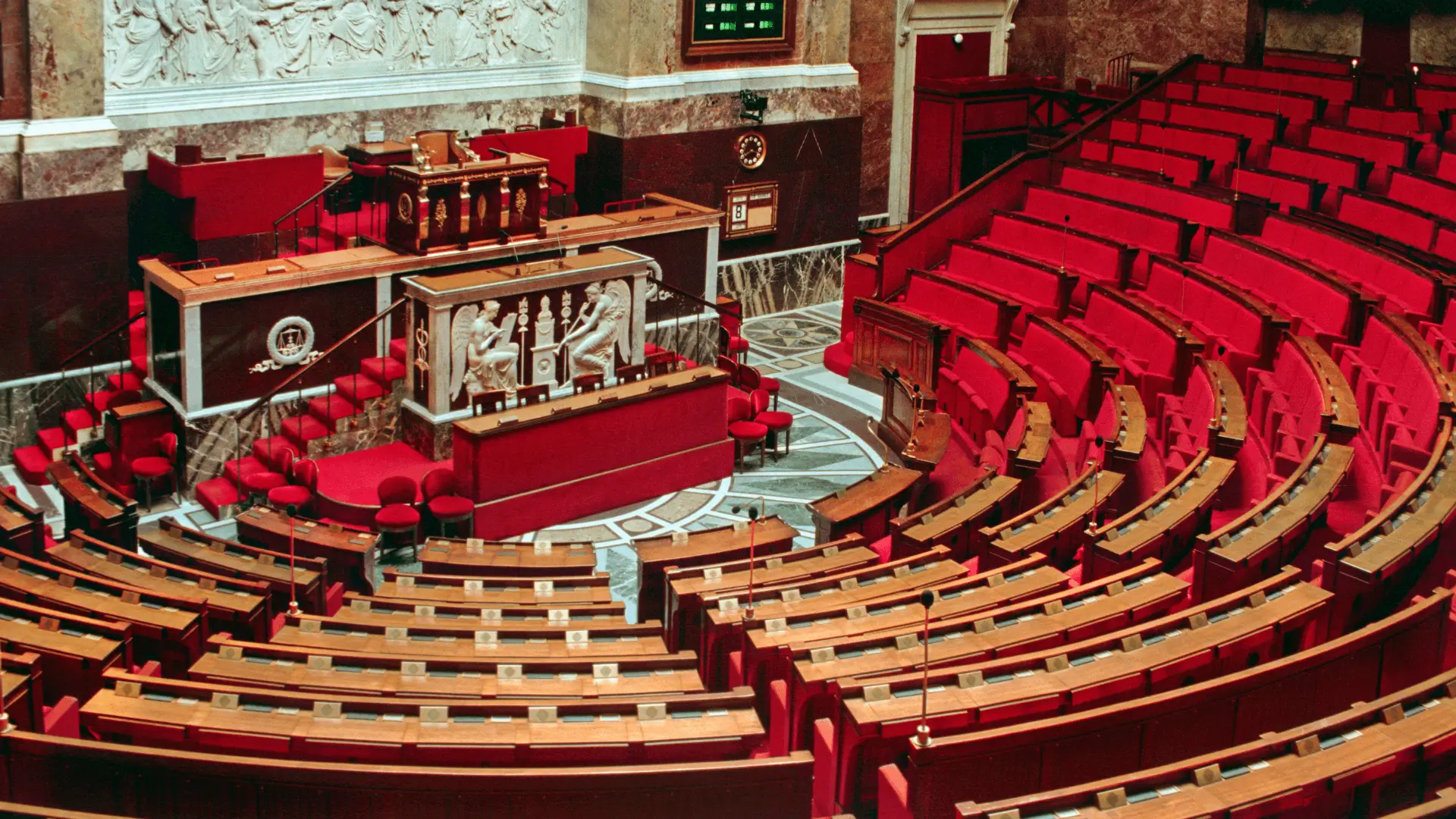



.svg)
.svg)







.svg)
