L'actualité paie RH, sociale et juridique des entreprises
Tenez vous informé des dernières évolutions et restez connecté !


Réduction de cotisations patronales pour les salariés sapeurs-pompiers volontaires
La loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est venue mettre en place une réduction de cotisations patronales pour les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires.
Un décret du 29 décembre 2023 ainsi que le BOSS sont venus apporter des précisions.
Quels sont les employeurs concernés ?
Sont concernés par les réductions de cotisations patronales les entreprises devant affilier les salariés à l’assurance chômage.
Sont exclus les particuliers employeurs, les EPIC, l’Etat, les collectives territoriales ainsi que les employeurs ayant un régime spécial (clercs et employés de notaire, marin, mines…)
Quels sont les salariés concernés ?
Sont concernés par la réduction patronale :
- Les salariés embauchés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et qui sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires avant leur recrutement.
- Les salariés déjà présents dans la société au 1er janvier 2024 mais devenant pompiers-volontaires pour la 1ère fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Par ailleurs, ces salariés devront remplir les conditions suivantes :
- Avoir une rémunération inférieure à 1.6 SMIC (rémunération brute soumise à cotisations)
- Avoir réalisé dans l’année civile (ou à compter de la date d’entrée) au moins une mission opérationnelle de secours d’urgence ou une mission de protection.
Chaque année civile, le montant de la réduction est évalué individuellement pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire, en fonction de sa participation aux missions opérationnelles relatives aux secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, à leur évacuation, ainsi qu’à la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Quelles sont les cotisations concernées et le montant de la réduction ?
Les employeurs de salariés répondant aux conditions citées ci-dessus bénéficient d’une réduction sur les cotisations patronales suivantes, qui sont calculées sur les rémunérations brutes soumises à cotisations et inférieures à 1,6 fois le SMIC :
- Cotisations pour les assurances sociales (maladie, vieillesse).
- Cotisations pour les allocations familiales.
- Fraction de cotisation Accidents du Travail/Maladies Professionnelles incluse dans la réduction générale de cotisations patronales.
- Cotisations pour le Fonds National d’Aide au Logement.
- Cotisations pour les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (AGIRC-ARRCO).
- Contribution de solidarité pour l’autonomie.
- Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, applicable sous certaines conditions, sur les avantages de retraite et d’invalidité, ainsi que sur les allocations de préretraite.
- Cotisations pour l’assurance chômage au taux de droit commun sans prise en compte d’un bonus/malus
Comment appliquer la réduction ?
Cette réduction pour les sapeurs-pompiers volontaires, qui se déclare chaque mois, s’applique sur la rémunération brute soumise à cotisations (idem que la rémunération prise en compte pour la réduction générale). En cas de déduction forfaitaire spécifique, la rémunération à retenir est le brut après réintégration des frais professionnels et abattement.
Le montant de la réduction correspond à la somme des cotisations mentionnées ci-dessus et après déduction de :
- La réduction générale de cotisations et contributions patronales
- La réduction des taux de cotisations patronales d’assurance maladie
- La déduction des cotisations patronales des heures supplémentaires
La réduction de cotisations est plafonnée à 2 000 € par an pour chaque salarié dans une limite annuelle globale de 10 000€ par entreprise. Pour les salariés cumulant plusieurs contrats sur une année civile, la réduction est également plafonnée à 10 000€ par an.
Ce plafond sera proratisé en fonction de la durée de travail du salarié (hors heures supplémentaires et complémentaires) et de la durée du contrat de travail.
Que faire en cas de cumul avec d’autres réductions et déductions spécifiques ?
Si le montant de la réduction excède le montant des cotisations et contributions restantes après l’application d’autres réductions et déductions spécifiques (taux réduit des cotisations d’assurance maladie ou d’allocations familiales, réduction générale de cotisations patronales et déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires), la réduction est plafonnée à ce dernier montant.
De plus, l’employeur ne peut cumuler cette réduction avec aucun autre dispositif d’exonération ou de réduction, hormis ceux énumérés ci-dessus.
Quelle preuve pour bénéficier de la réduction ?
L’employeur doit tenir à disposition du contrôleur une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Nouveautés Sociales 2024 pour la Gestion de la Paie et des RH
Retour sur les principales nouveautés sociales à ne pas manquer pour l’année 2024 :
- La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024, publiée au JO le 27.12.2023
- La loi de finances pour 2024 publiée au JO le 30.12.2023
On vous explique tout !
Les mesures RH
Loi de financement de la sécurité sociale 2024
Arrêts de travail :
- Pas de délai de carence IJSS en cas d’interruption médicale de grossesse : Cette mesure prendra effet à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 01/07/2024
- La durée des arrêts de travail (arrêt initial ou prolongation) délivrées par télémédecine est limitée à 3 jours.
- Information du salarié si la médecine du travail juge l’arrêt de travail pas ou plus justifié
Retraite progressive :
- Pour les mandataires sociaux : sécurisation pour eux de bénéficier de la retraite progressive
- Pour les salariés bénéficiant d’un avantage de préretraite : exclusion du bénéfice de la retraite progressive
- Rétablissement des activités non éligibles à la retraite progressive
- Correction d’une incohérence : possibilité de demander le passage à temps partiel ou réduit au moment où le salarié souhaite bénéficier de la retraite progressive et non plus au moment où le salarié est en droit d’en bénéficier
Allocation journalière d’un proche aidant :
Création d’un droit rechargeable à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 01/01/2025.
Loi de finances pour 2024
Frais domicile/lieu de travail :
- Reconduction pour 2024 des mesures exceptionnelles prévues par la loi de finances rectificative 2022
- A compter de 2025, majoration de 100€ des plafonds d’exonération soit :
- 600€ pour le prime transport et le forfait mobilités dont 300€ pour les frais de carburant
- 900€ en cas de cumul forfait mobilités durables et remboursement des abonnements transports en commun
Les mesures cotisations sociales et URSSAF
Loi de financement de la sécurité sociale 2024
Contributions conventionnelles de formation et de dialogue social :
transfert aux URSSAF du recouvrement au plus tôt en 2026.
Cotisations AGIRC-ARRCO et APEC :
abandon du projet de recouvrement par l’URSSAF + possibilité pour l’URSSAF, l’AGIRC-ARRCO et la MSA d’organiser des opérations afin de vérifier les déclarations DSN
Régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle :
clarification pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite. Même si l’indemnité est imposable, elle bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS à hauteur du montant le plus élevé entre :
- Indemnité légale ou conventionnelle
- 50% de l’indemnité
- 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié
Réductions de taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocation familiale :
possibilité pour le Gouvernement de passer par décret afin de décorréler le plafond de salaire de l’évolution du SMIC -> un décret a figé le SMIC de référence au 31 décembre 2023
Effectif « sécurité sociale » :
pour les salariés mis à disposition par un groupement d’employeur, ils sont comptabilisés au niveau de la société utilisatrice sauf pour la tarification AT/MP à compter d’une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 01/01/2026.
Entreprises étrangères sans établissement en France :
suppression au 01/03/2024 de la possibilité de désigner un représentant firme étrangère en France pour effectuer les déclarations et versements des cotisations sociales.
Titre emploi simplifié agricole :
intégration dans la DSN des TESA et pérennisation des TESA-S
Contrôle URSSAF :
simplification de la procédure d’abus de droit avec la suppression du comité des abus de droit. En outre, les entreprises pourront demander une prolongation de la période contradictoire à compter du 1er janvier 2024 et ce, même en cas de procédure d’abus de droit.
Services à la personne :
à compter du 01/01/2025, nouveaux cas de dispenses d’activité exclusive pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux
Loi de finances pour 2024
Zones de revitalisation (ZRR) et zones France ruralités revitalisation (ZFRR) :
remplacement des ZRR par les ZFRR au 01/07/2024
Bassins d’emploi de redynamiser :
Prolongation jusqu’au 31/12/2026 de la fenêtre d’implantation pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales
Contribution supplémentaire à l’apprentissage :
Les alternants mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte dans l’effectif d’alternants de la société utilisatrice
Versement mobilité :
Prévision d’une hausse du taux pour Paris et la petite couronne à 3.20% à compter du 01/02/2024
Jeunes entreprises de croissance :
Création d’un nouveau type de JEI bénéficiant d’exonérations de cotisations sociales.
Ces nouvelles jeunes entreprises se caractérisent par :
- Des dépenses de recherche plus faible que les JEI : 5 à 15% de charges fiscalement déductibles
- Un critère de performance économique (à préciser par décret)
Taux de PAS pour les couples soumis à imposition commune :
A compter du 01/09/2025, ce sont les taux individualisés qui s’appliqueront par défaut et non le taux unique par foyer fiscal
Pourboires volontaires :
Exonérations sociales et fiscales exceptionnelles des pourboires pour les salariés moins de 1.6 SMIC prolongées pour 2024
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Les Tickets-Restaurant en France en 2024 : ce que les employeurs et employés doivent savoir
Avec l’année 2024 approchant, il est essentiel pour les employeurs et employés en France de se tenir informés des dernières évolutions concernant les tickets-restaurant. Ces titres, utilisés par environ cinq millions de Français, offrent un avantage non négligeable dans le monde du travail.
Alors que les mesures dérogatoires permettant aux salariés de payer toutes les courses alimentaires avec les titres-restaurant devaient prendre fin au 31 décembre 2023, une loi publiée au JO le 27 décembre 2023 prévoit leur prolongation pour l’année 2024. Voici ce que vous devez savoir pour l’année prochaine.
Prolongation des mesures dérogatoires en 2024
Contrairement à des annonces antérieures, les restrictions sur l’utilisation des tickets-restaurant ne prendront pas fin au 31 décembre 2023.
Ainsi, dès le 1er janvier 2024, les employés pourront continuer à utiliser leurs tickets comme ils l’ont fait tout le long de l’année 2023. Cela signifie que les tickets pourront toujours être utilisés pour acheter une large gamme de produits alimentaires, y compris des articles tels que les pâtes ou le riz, sans se limiter aux produits directement consommables tels que les sandwichs ou les plats préparés.
Vers une Dématérialisation Complète
Alors que l’utilisation quotidienne des tickets reste inchangée, le gouvernement maintient son objectif de dématérialiser complètement ces titres d’ici 2026.
Cela implique la disparition progressive des tickets-restaurant sous forme papier, au profit de versions numériques, utilisables via des cartes spéciales ou des applications mobiles. Cette transition vise à simplifier la gestion et l’utilisation des tickets, tant pour les employeurs que pour les employés.
Ainsi, pour les employeurs utilisant toujours la version papier des tickets-restaurant, nous vous recommandons de commencer à planifier la transition vers des solutions dématérialisées.
Il est conseillé de se familiariser avec les différentes options disponibles et de préparer les employés à cette évolution. Cela pourrait inclure des formations sur l’utilisation des applications ou des cartes numériques.
Conclusion
Les tickets-restaurant restent un élément clé des avantages sociaux en France. En 2024, ils continueront à offrir de la flexibilité aux employés, tout en amorçant une transition vers une ère plus numérique. Pour les employeurs, cette période est une opportunité pour se préparer à ces changements et assurer une transition en douceur pour tous les utilisateurs.
Préparez-vous pour les Changements des Tickets-Restaurant en 2024 ! Chez Paie RH Solutions, nous vous offrons une expertise approfondie et des conseils personnalisés pour gérer efficacement vos avantages salariaux.
Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution des tickets-restaurant, vous pouvez également consulter notre fiche pratique sur le sujet.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Informations obligatoires des salariés sur la relation de travail
La loi du 9 mars 2023, complétée par le décret du 30 octobre 2023, impose aux employeurs de fournir aux salariés un ensemble d’informations précises sur leur relation de travail. Ces mesures, issues du droit européen, visent à renforcer la transparence et à sécuriser la relation employeur-salarié.
Quelles informations doivent être fournies aux salariés ?
Informations à transmettre au plus tard dans les 7 jours suivant l’embauche
L’employeur doit communiquer dès l’arrivée du salarié :
- l’identité des parties (employeur et salarié),
- le lieu de travail et l’adresse de l’employeur,
- le poste occupé, les fonctions et la classification,
- la date d’embauche,
- en cas de CDD : la date de fin ou la durée du contrat,
- la durée et les conditions de la période d’essai,
- la durée de travail, les modalités de recours aux heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que l’organisation du temps de travail,
- le montant de la rémunération, les majorations prévues pour les heures supplémentaires et la périodicité de paiement.
Informations à transmettre au plus tard dans le mois suivant l’embauche
Dans un délai d’un mois maximum, l’employeur doit préciser :
- les droits à la formation,
- la durée des congés payés ou la méthode de calcul de cette durée,
- les procédures en cas de rupture du contrat de travail,
- les conventions et accords collectifs applicables,
- les régimes collectifs obligatoires (protection sociale, prévoyance, mutuelle…).
Cas particuliers
Salariés travaillant à l’étranger plus de 4 semaines
Des informations supplémentaires doivent être fournies, telles que :
- le pays d’affectation,
- la devise de rémunération,
- les avantages liés à la mission,
- les conditions de rapatriement.
Ces obligations s’appliquent également aux salariés détachés dans le cadre d’une prestation de service transnationale.
Salariés en CDD
L’employeur doit informer les salariés en CDD depuis au moins 6 mois des postes en CDI disponibles dans l’entreprise.
Le salarié doit en faire la demande par écrit (ou tout moyen permettant de donner une date certaine). L’employeur dispose alors d’un délai d’un mois pour répondre par écrit en listant les postes correspondants à la qualification du salarié.
⚠️ L’employeur est dispensé de cette obligation après deux demandes formulées dans la même année civile.
À partir de quand ces obligations s’appliquent-elles ?
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er novembre 2023.
Pour les salariés déjà en poste à cette date, et n’ayant pas reçu ces informations, ils peuvent en faire la demande à tout moment. L’employeur devra répondre dans les délais légaux : 7 jours ou 1 mois selon la nature de l’information demandée.
Comment transmettre ces informations ?
L’employeur doit communiquer ces éléments par tout moyen donnant une date certaine à l’information, que ce soit sur support papier ou par voie électronique.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)

Nouveauté sur les Bulletins de Paie : le Montant Net Social
Le montant net social correspond à la somme totale des revenus bruts perçus par le salarié de la part de l’employeur (salaires, primes, heures supplémentaires, avantages en nature, indemnités de rupture, etc.), à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
👉 À compter du 1er janvier 2024, les IJSS subrogées seront également intégrées dans le calcul du montant net social.
À quoi sert le montant net social ?
Le montant net social est une mention désormais obligatoire sur le bulletin de paie. Il sert de revenu de référence pour les assurés sociaux et permet :
- de calculer certaines prestations sociales comme le RSA et la prime d’activité,
- de simplifier les démarches administratives des salariés,
- d’éviter les erreurs de déclaration auprès des organismes sociaux.
Un montant obligatoire sur le bulletin de paie
Depuis juillet 2023, le montant net social doit figurer obligatoirement sur les bulletins de paie pour les salariés en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
En revanche, cette obligation ne s’applique pas :
- dans les autres territoires français,
- à Andorre et Monaco.
Le montant net social n’est pas non plus exigé dans les situations où le bulletin de paie n’est pas obligatoire (stagiaire non rémunéré, préretraite avec rupture du contrat…). Toutefois, il reste conseillé de le faire apparaître dans les attestations ou documents de synthèse.
⚠️ En cas d’omission, l’employeur s’expose à des sanctions pour non-respect de ses obligations déclaratives.
Comment est calculé le montant net social ?
Le calcul du montant net social évolue entre 2023 et 2024.
👉 Jusqu’au 31 décembre 2023
- Sont inclus : les rémunérations brutes (hors IJSS et versement santé).
- Sont déduites : les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, AGIRC-ARRCO, chômage, CSG/CRDS, etc.), ainsi que la part salariale des cotisations finançant une complémentaire santé obligatoire.
- Sont réintégrées : certaines cotisations patronales de protection sociale complémentaire (hors complémentaire santé obligatoire).
👉 À partir du 1er janvier 2024
- Sont incluses : les rémunérations brutes versées par l’employeur, sauf les IJSS non subrogées et le versement santé.
- Sont déduites : l’ensemble des cotisations et contributions sociales salariales finançant des garanties collectives (qu’elles soient obligatoires ou non), ainsi que la part salariale des options individuelles liées à ces garanties.
- Sont exclues : les cotisations patronales, qui ne sont plus à réintégrer.
En clair : à partir de 2024, des éléments comme la prévoyance ou la retraite supplémentaire deviennent déductibles du montant net social.
Quand doit-il apparaître sur le bulletin ?
Le montant net social doit figurer sur les bulletins de paie à compter de juillet 2023.
Le ministère du Travail a précisé que cette mention est liée à la date de versement du salaire, et non à la période travaillée.
Par exemple :
- pour une paie de juin 2023 versée en juillet, le bulletin de juillet doit inclure le montant net social.
- une tolérance a été prévue, permettant aux entreprises de le mentionner à partir des paies de juillet 2023 (versées en août).
Que faire en cas d’erreur ou de contestation ?
Deux cas de figure sont distingués :
- Erreur ou désaccord sur la rémunération : si le calcul du salaire est incorrect, il faut corriger selon les procédures habituelles (bulletin rectificatif ou régularisation).
- Erreur uniquement sur le net social : si le salaire versé est correct mais que le montant net social est erroné, l’employeur doit soit émettre un bulletin corrigé, soit régulariser sur la paie suivante.
À partir de 2024, tout salarié pourra demander une rectification en cas d’anomalie.
👉 À retenir : le montant net social devient un indicateur central de la paie. Sa généralisation vise à harmoniser les déclarations sociales et simplifier les droits des salariés. Les employeurs doivent s’assurer de sa bonne intégration dès 2024 pour éviter les sanctions.
.svg%20fill.svg)
.svg%20fill.svg)


.svg)
.svg)
.svg)
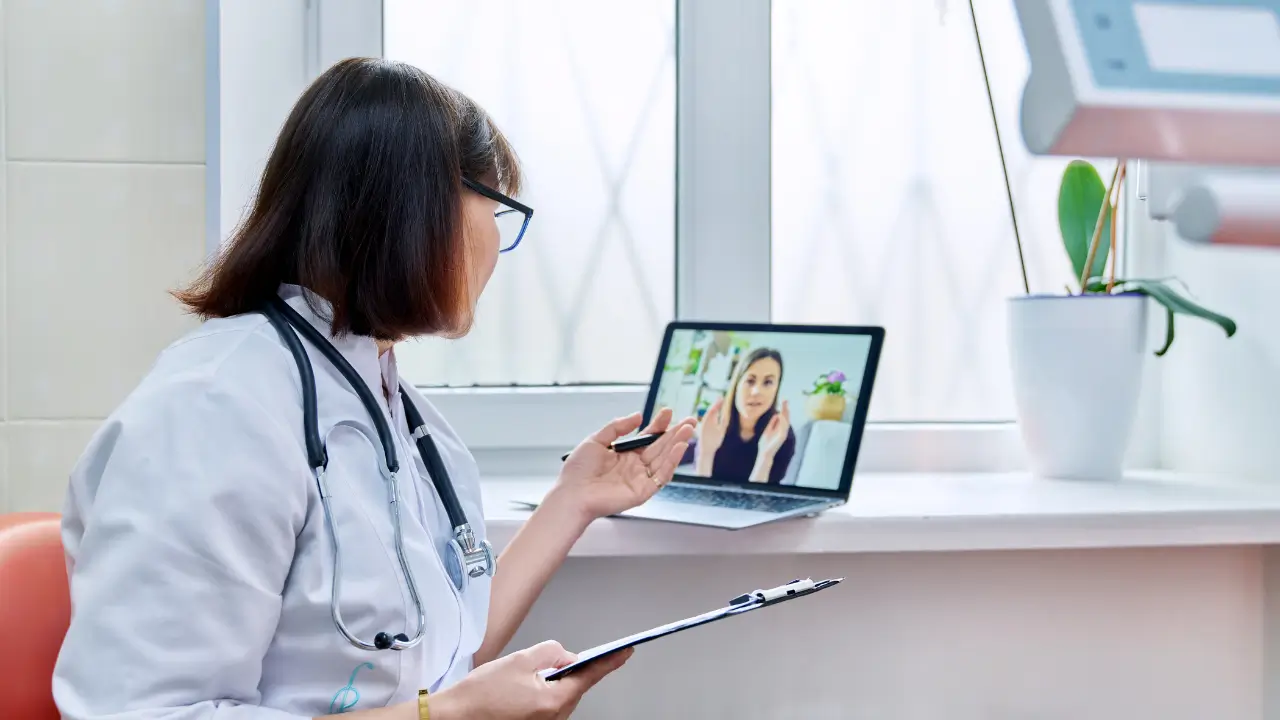










.svg)
