La période de reconversion : nouveau dispositif pour faciliter les mobilités professionnelles

Avec la publication au Journal officiel du 25 octobre 2025 de la loi relative à l’emploi des séniors, au dialogue social et aux transitions professionnelles, un nouveau dispositif de reconversion professionnelle est instauré : la période de reconversion.
Issue de la transposition de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 25 juin 2025, cette nouveauté marque ainsi la fin de deux outils — la Pro-A et les Transitions collectives.
Applicable dès le 1er janvier 2026, ce nouveau dispositif a pour objectif de simplifier les transitions professionnelles, de sécuriser les parcours et d’accompagner les transformations rapides des métiers et des organisations.
Voici un décryptage complet de ses objectifs, son fonctionnement et ses impacts pour les entreprises comme pour les salariés.
Une fusion de deux dispositifs existants : la pro-A et les Transitions collectives
La période de reconversion constitue la réponse législative à un constat partagé par les partenaires sociaux : les dispositifs précédents, Pro-A et Transco étaient jugés trop techniques pour être réellement déployés en masse.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, ces dispositifs disparaîtront au profit du cadre unique de la période de reconversion :
- Transitions collectives (Transco), qui permettait de financer des reconversions vers des métiers en tension ;
- Pro-A, centrée sur la reconversion ou la promotion par alternance.
Seules les périodes de Pro-A ayant fait l’objet d’un avenant conclu avant cette date continueront d’être régies par les anciennes dispositions.
Un dispositif facilitant les mobilités internes et externes
Pour quels salariés ?
Tous les salariés peuvent prétendre à ce nouveau dispositif, que la mobilité visée se déroule au sein de leur entreprise ou à l’extérieur.
Le salarié peut mobiliser, pendant son temps de travail, le conseil en évolution professionnelle (CEP).
Il peut également recourir à une PMSMP (période de mise en situation en milieu professionnel) pour confirmer son projet ou découvrir un métier.
Pour quels objectifs ?
La période de reconversion permet d’accéder :
- à une certification RNCP,
- à un CQP,
- à un ou plusieurs blocs de compétences,
- ou encore au socle de connaissances et de compétences (CléA).
Elle peut aussi inclure une VAE ou des périodes d’exercice professionnel permettant d’acquérir directement un savoir-faire.
Pour quelle durée ?
Les actions de formation doivent représenter entre 150 et 450 heures sur 12 mois maximum.
Un accord collectif peut étendre ces durées jusqu’à :
- 2 100 heures,
- 36 mois.
Cette souplesse permettra d’adapter les parcours à des reconversions exigeantes, notamment dans les métiers techniques ou les filières à forte mutation.
Par ailleurs, durant sa formation, le salarié bénéficie de la couverture AT/MP, ce qui assure une continuité de protection sociale.
Les différents effets sur le contrat de travail
La période de reconversion peut prendre deux formes, aux impacts très différents sur le contrat de travail.
La reconversion interne : un contrat maintenu, une rémunération inchangée
Lorsque la reconversion se déroule dans l’entreprise d’origine, un accord écrit doit définir les modalités de la période.
Pendant toute la durée du dispositif :
- le contrat de travail n’est pas suspendu,
- La rémunération du salarié reste identique.
Cette option est particulièrement adaptée aux entreprises souhaitant requalifier en interne leurs salariés pour répondre à des évolutions structurelles : digitalisation, transition écologique, nouveaux process industriels, etc.
La reconversion externe : un contrat suspendu mais un retour garanti
Si la reconversion se déroule dans une autre entreprise, le contrat initial est suspendu. Un accord écrit doit préciser :
- la durée de suspension,
- les modalités d’un éventuel retour anticipé en cas d’échec de la période d’essai.
Dans l’entreprise d’accueil, la période de reconversion prend la forme d’un :
- CDI, ou
- CDD d’au moins 6 mois, un nouveau motif légal de recours au CDD ayant été créé à cet effet.
À l’issue de la période d’essai :
- si elle est concluante, le contrat d’origine est rompu par rupture conventionnelle (CDI) ou rupture d’un commun accord (CDD) ;
- si elle échoue, le salarié peut réintégrer son entreprise d’origine dans un poste identique ou équivalent, avec rémunération équivalente. En cas de refus de réintégration, la rupture se fait selon les modalités évoquées ci-dessus.
Vous pouvez consulter notre fiche pratique sur la rupture conventionnelle ainsi que notre fiche pratique sur la gestion de la fin des CDD pour avoir plus d'informations sur ces sujets.
Une mise en œuvre structurée selon la taille de l’entreprise
La loi encadre strictement les conditions de déploiement des reconversions externes, notamment selon la taille de l'entreprise et la présence d'un délégué syndical.
Les entreprises de moins de 50 salariés ou de 50 à 300 salariés sans DS
La mise en place peut se faire par décision unilatérale, après consultation du CSE.
Pour en savoir plus sur la décision unilatérale, nous vous invitons à lire notre fiche pratique dédiée à ce sujet.
Les entreprises de 50 à 300 salariés disposant d’un DS
Les périodes de reconversion externe sont mises en place dans le cadre d’une Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) ou d’un accord de rupture conventionnelle collective (RCC).
Une négociation doit être ouverte si 10 % des salariés a vocation à bénéficier d’une reconversion externe sur 12 mois à compter de la date de début des négociations.
À défaut d’accord dans les 3 mois un PV de désaccord est établi et l’employeur peut décider unilatéralement des conditions de mise en œuvre.
Les entreprises de plus de 300 salariés
Là encore, les périodes de reconversion externe doivent passer par GEPP ou RCC.
Contrairement aux entreprises de moins de 300 salariés, un accord collectif est impératif.
Aucune décision unilatérale n’est possible.
Cette mise en œuvre s’applique également pour les entreprises (ou groupes) de dimension communautaire et qui a au moins un établissement en France d’au moins 150 salariés.
Contenu obligatoire de l’accord ou de la décision unilatérale
L’accord ou la DUE doit notamment préciser :
- la prise en charge d’un éventuel écart de rémunération,
- les conditions d’allongement de la formation,
- les indemnités en cas de rupture,
- les modalités d’utilisation du CPF du salarié,
- la possibilité de prise en charge par l’OPCO.
Un financement partagé et optimisé
Rôle central des OPCO
Les OPCO prendront en charge les frais pédagogiques, les frais annexes et potentiellement la rémunération.
Les niveaux de prise en charge seront déterminés par les branches, selon des critères tels que :
- l’ancienneté,
- l’âge,
- les mutations de l’activité,
- le risque d’obsolescence des compétences.
Le CPF comme complément
La formation peut être cofinancée par le salarié via son CPF, dans la limite :
- de 50 % des droits inscrits sur le compte pour une reconversion interne,
- de 100 % pour une reconversion externe.
Aucune autre contribution financière ne peut être exigée.
Pour consulter votre CPF, vous pouvez aller sur le site de moncompteformation.
Dialogue social renforcé : un rôle accru du CSE et de la BDESE
La consultation du CSE sur la politique formation devra désormais porter explicitement sur les périodes de reconversion.
La BDESE devra également inclure des informations sur leur mise en œuvre ainsi qu'un bilan annuel obligatoire, relevant du bloc d’ordre public.
Si vous souhaitez des précisions sur le CSE et ses missions, nous avons une fiche pratique dédiée à ce sujet.
Une nouvelle garantie pour les congés de transition professionnelle
La loi introduit une avancée importante pour les salariés en congé de transition professionnelle.
L’employeur devra notifier, par écrit et trois mois avant la fin de la formation :
- le droit du salarié à réintégrer son poste ou un poste équivalent,
- ainsi que le délai d’un mois dont il dispose pour répondre.
Le silence vaut acceptation.
Cette mesure s’applique au 1er janvier 2026.
Pour consulter la loi instaurant ce nouveau dispositif, vous pouvez vous rendre sur le site de Légifrance.


.svg)
.svg)
.svg)

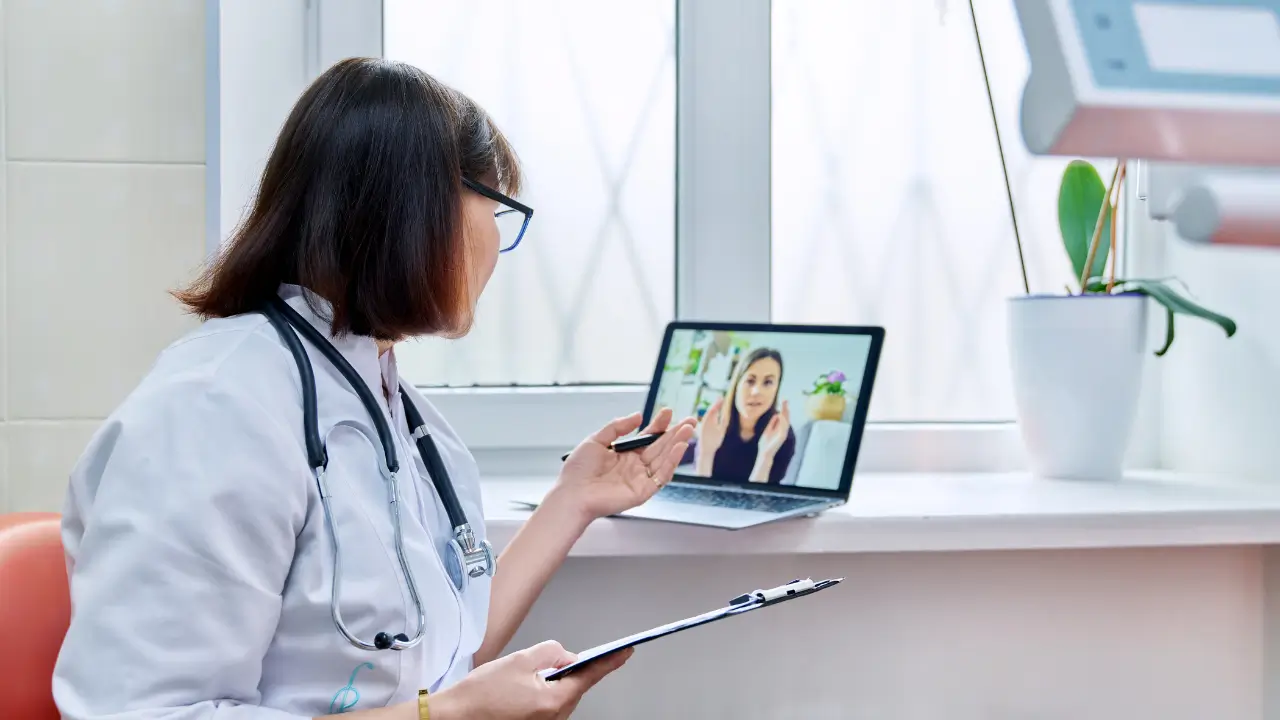


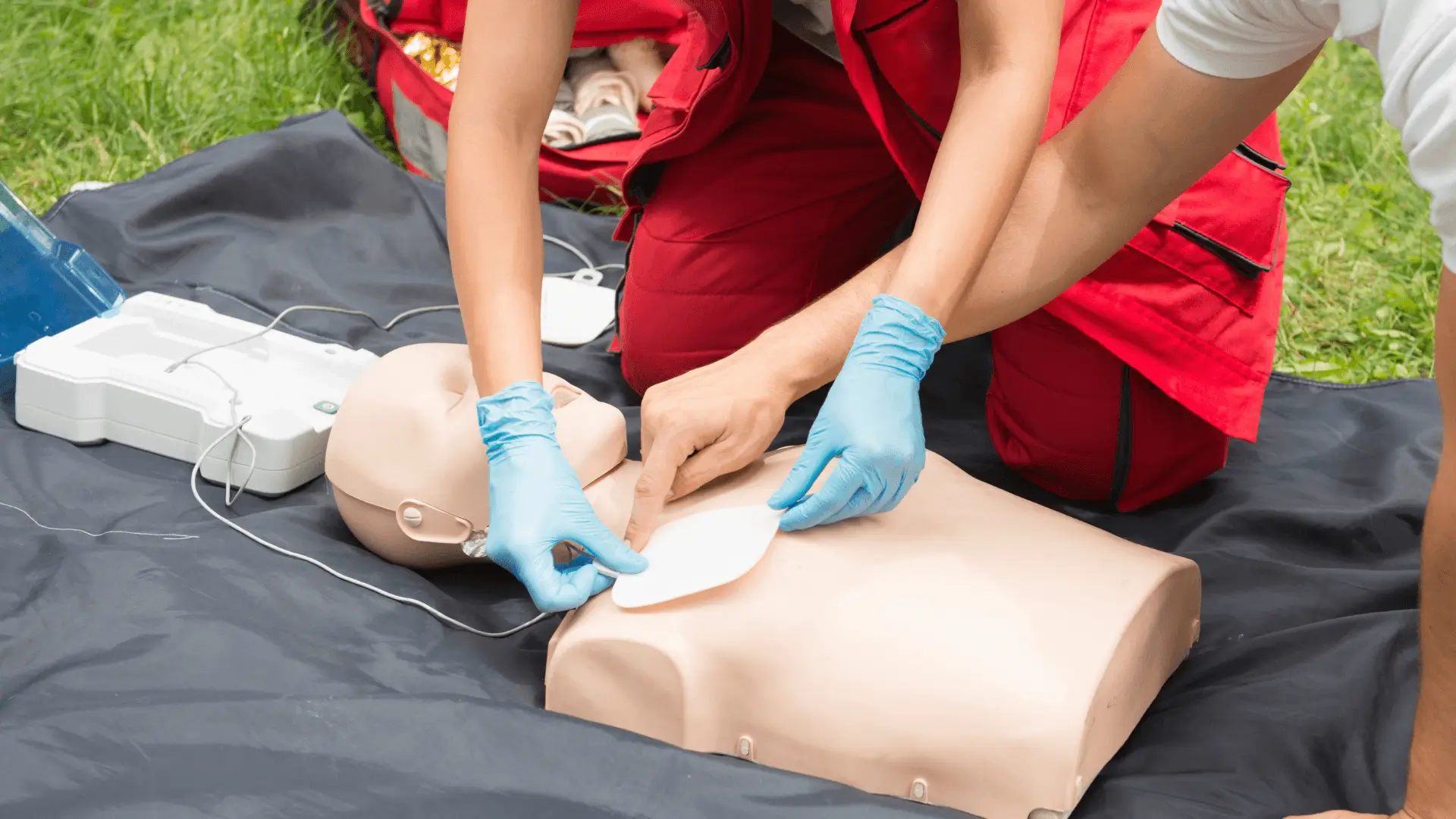





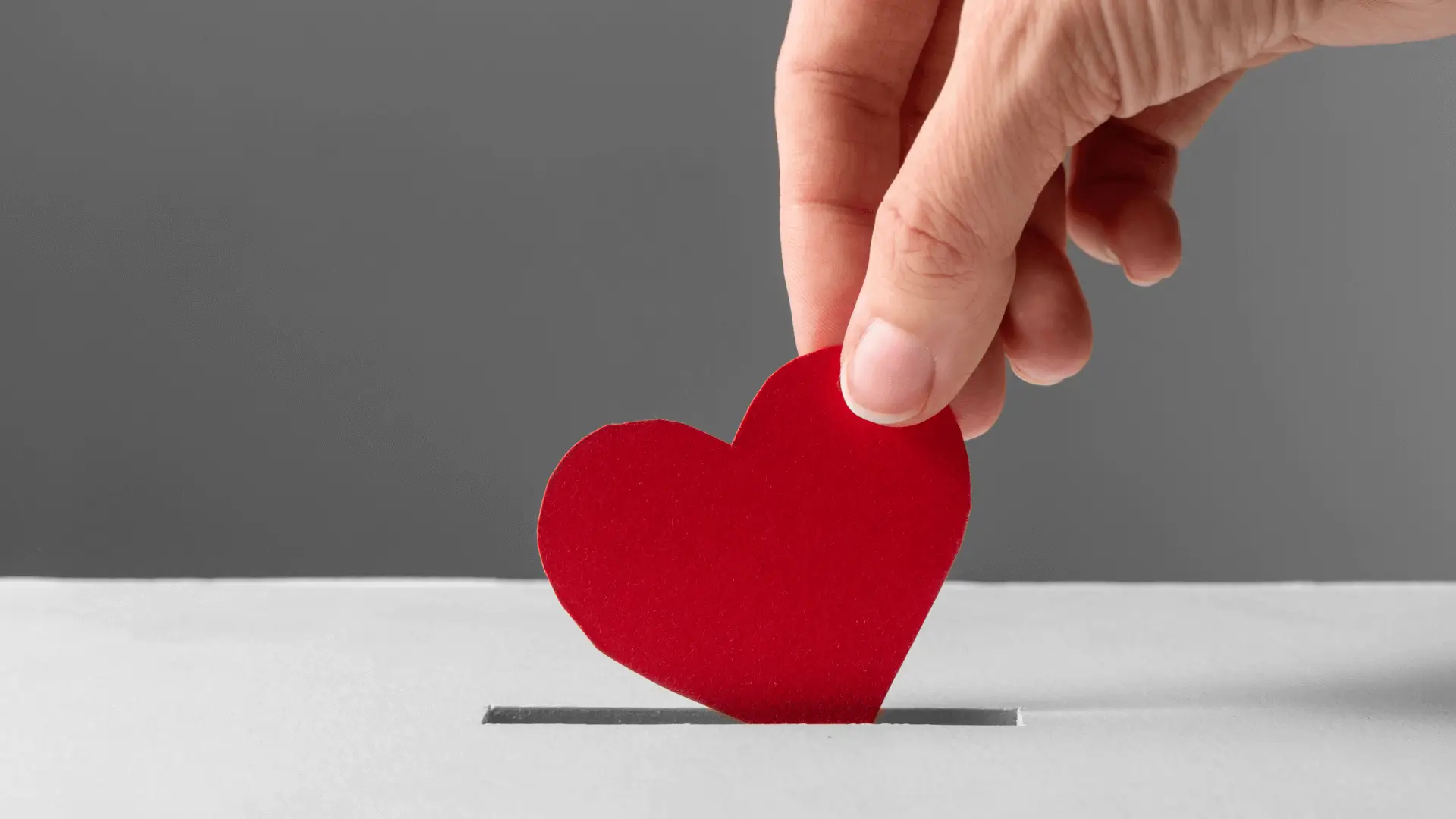




.svg)
.svg)







.svg)
